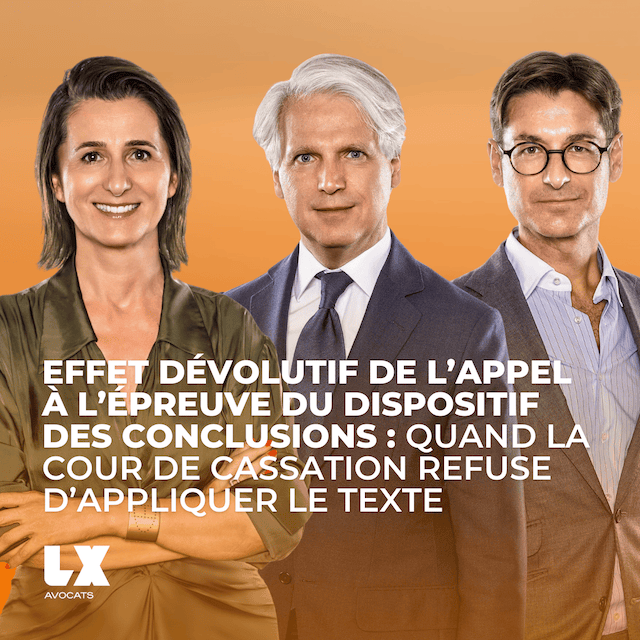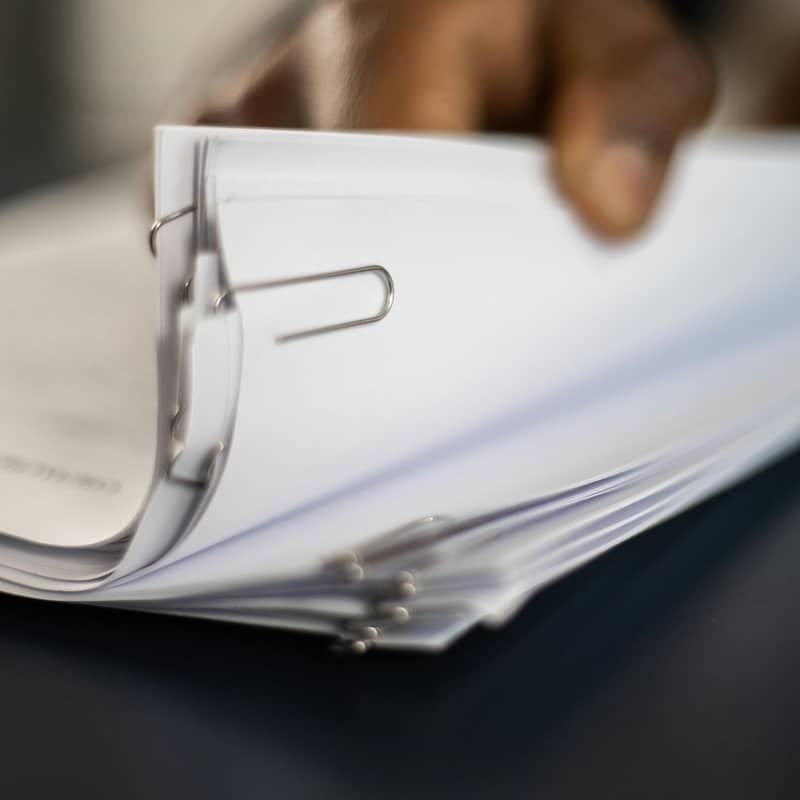La deuxième chambre civile, par un avis du 20 novembre 2025, juge que l’absence de reprise, dans le dispositif des premières conclusions, des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel n’emporte pas perte de l’effet dévolutif, dès lors que l’appelant n’use pas de la faculté prévue par l’article 915-2 du code de procédure civile. Une solution pragmatique, mais dont la cohérence textuelle interroge. Interview d'Emmanuelle VAJOU, Matthieu BOCCON-GIBOD et Romain LAFFLY, avocats associés LX, pour Dalloz Actualité.
Pourriez-vous nous rappeler la portée et les enjeux de l’effet dévolutif en appel ?
Matthieu Boccon-Gibod : L’appel, voie de réformation par excellence, n’opère plus depuis longtemps dévolution générale. Depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appelant doit, notamment à peine de nullité, mentionner dans sa déclaration d’appel les chefs du dispositif du jugement qu’il entend critiquer. Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, présenté comme portant « simplification » de la procédure d’appel, a cru bon d’ajouter un élément additionnel : l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile impose désormais que l’appelant « énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués » dans le dispositif de ses conclusions.
Romain Laffly : Le décret de mai 2017 a en effet sonné le glas de l’appel dit « total ». Mais les problèmes sont apparus lorsque la Cour de cassation est passée de la sanction d’une nullité de forme, qui ne fait plus peur à personne, à celle d’une absence d’effet dévolutif, qui effraye à peu près tout le monde. Elle a en effet estimé que seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement de sorte que s’il ne les vise pas, l’effet dévolutif n’opère pas et la cour d’appel doit constater qu’elle n’est pas saisie (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n° 18-22.528, Dalloz actualité, 17 févr. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2020. 288 ; ibid. 576, obs. N. Fricero ; ibid. 1065, chron. N. Touati, C. Bohnert, S. Lemoine, E. de Leiris et N. Palle ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero ; D. avocats 2020. 252, étude M. Bencimon ; RTD civ. 2020. 448, obs. P. Théry ; ibid. 458, obs. N. Cayrol ).
Matthieu Boccon-Gibod : Avec ce nouveau texte, fallait-il y voir une condition supplémentaire de l’effet dévolutif, ou une simple exigence formelle dépourvue de sanction autonome ? La question, d’apparence technique, recèle des enjeux considérables pour le justiciable : la perte de l’effet dévolutif sur un chef de jugement équivaut à la confirmation définitive de ce chef, sans que la cour d’appel ne puisse même l’examiner.
La Cour d’appel de Paris, confrontée à cette difficulté – elle n’était pas la seule –, a sollicité l’avis de la Cour de cassation. La réponse, rendue le 20 novembre 2025, se veut rassurante pour les praticiens. Elle n’en soulève pas moins des interrogations doctrinales substantielles.
Quelle était la question posée à la Cour de cassation ?
Emmanuelle Vajou : La demande d’avis, émanant du pôle 4, chambre 5, de la Cour d’appel de Paris, était ainsi formulée : « En l’absence de toute reprise (des chefs du dispositif du jugement critiqués) dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont-ils dévolus à la cour ? ». La configuration procédurale était classique : un appelant avait, dans sa déclaration d’appel, expressément mentionné les chefs du jugement critiqués, conformément à l’article 901 du code de procédure civile. Toutefois, dans le dispositif de ses premières conclusions, il n’avait pas repris cette énumération, se contentant de solliciter l’infirmation de la décision frappée d’appel. L’intimé en tirait argument pour soutenir l’absence d’effet dévolutif.
La deuxième chambre civile, statuant en formation de section, délivre un avis publié au Bulletin dont la formulation mérite attention. Après avoir rappelé les objectifs politiques du décret du 29 décembre 2023 – « réduction des incidents conduisant à une extinction prématurée de l’instance d’appel en raison d’erreurs procédurales » et « atténuation des conséquences d’un formalisme de la procédure d’appel jugé parfois excessif » –, la Cour énonce que l’article 915-2, alinéa 1er, du code de procédure civile « instaure une simple faculté offerte à l’appelant » de compléter, retrancher ou rectifier les chefs critiqués dans ses premières conclusions.
La conclusion s’imposait alors avec la force de l’évidence : « si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions ».
Quelle était la position des cours d’appel avant cet avis ?
Matthieu Boccon-Gibod : L’avis de la Cour de cassation s’inscrit dans le sillage de plusieurs décisions d’appel qui avaient anticipé cette solution. La Cour d’appel de Lyon, le 2 octobre 2025, avait jugé que l’article 915-2 « ne dispose pas que ces premières conclusions doivent effectivement reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqué mais il permet seulement de moduler le périmètre de l’effet dévolutif de l’appel réalisé par la déclaration d’appel » (Lyon, 2 oct. 2025, n° 25/00155). La Cour d’appel de Rennes, le 26 juin 2025, avait adopté une motivation similaire, soulignant que « l’usage du verbe pouvoir au premier alinéa de l’article 915-2 implique que le fait de compléter, retrancher ou rectifier […] ne procède que d’une simple possibilité et non d’une obligation » (Rennes, 26 juin 2025, n° 24/05953).
Ces juridictions du fond, confrontées quotidiennement aux aléas du formalisme procédural, avaient perçu le risque d’une sanction disproportionnée. La perte de l’effet dévolutif pour défaut de reprise formelle des chefs critiqués au dispositif des premières conclusions d’appel, alors même que la déclaration d’appel les mentionnait expressément, aurait constitué un piège procédural d’autant plus redoutable qu’aucun texte n’énonçait clairement une telle sanction.
Emmanuelle Vajou : Il est vrai aussi que certaines cours d’appel n’avaient pas cette approche et s’en tenaient à la lettre du texte, à l’instar de la Cour de Dijon pour laquelle le fait de demander la réformation au dispositif de ses conclusions sans détailler les chefs de jugement critiqués devait conduire à la caducité de la déclaration d’appel (Dijon, 12 juin 2025, n° 24/01439, Dalloz actualité, 9 juill. 2025, obs. C. Bléry).
Pourquoi alors une telle solution qui écarte l’obligation de lister les chefs du jugement critiqués au dispositif des conclusions ?
Matthieu Boccon-Gibod : La Cour de cassation fait ici oeuvre d’interprétation téléologique. Elle privilégie la finalité du texte – la simplification procédurale – sur sa lettre, qui aurait pu conduire à une lecture plus rigoriste. L’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile dispose pourtant que l’appelant « énonce » les chefs critiqués dans le dispositif de ses conclusions. Le verbe « énoncer », conjugué à l’indicatif présent, revêt ordinairement une valeur prescriptive en légistique.
La Haute juridiction contourne l’obstacle en concentrant son raisonnement sur l’article 915-2 qui emploie le verbe « pouvoir » : l’appelant « peut compléter, retrancher ou rectifier » les chefs critiqués. De cette faculté, la Cour déduit a contrario que l’absence de modification vaut maintien du périmètre initial de la dévolution, tel que fixé par la déclaration d’appel.
Cette lecture trouve un appui dans la jurisprudence constante selon laquelle « seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement » (Civ. 2e, 30 avr. 2025, n° 23-18.993). La déclaration d’appel constitue l’acte fondateur de la saisine de la cour ; les conclusions, fussent-elles les premières, ne sauraient modifier rétroactivement cette saisine que dans les cas expressément prévus par la loi.
Romain Laffly : On peut effectivement y voir une approche téléologique qui ne dit pas son nom. Car la dernière fois où elle a utilisé cette méthode, la deuxième chambre civile l’a clairement dit et revendiqué ! C’était à propos de l’annexe à la déclaration d’appel, et déjà dans une procédure d’avis, mais pour dire quelle était la volonté des auteurs d’un décret qui autorisait ce recours à l’annexe en dépit de la maladresse rédactionnelle (Civ. 2e, avis, 8 juill. 2022, n° 22-70.005, Dalloz actualité, 30 août 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 1498 , note M. Barba ; AJ fam. 2022. 496, obs. D. D’Ambra ).
Mais le trouble vient aujourd’hui du fait que, cette fois, c’est la recherche de son propre souhait qui a été privilégié, pas le but recherché par les rédacteurs du texte.
Aucun doute là-dessus, la circulaire de présentation du décret émanant de la Direction des affaires civiles et du Sceau du 2 juillet 2024 précisait en effet que « lorsque l’infirmation est demandée, le décret exige que les chefs du dispositif du jugement critiqués soient listés dans le dispositif des conclusions de l’appelant » et que ces chefs « devront désormais obligatoirement être mentionnés dans ce dispositif ». La Chancellerie avait même pris soin de donner un exemple de dispositif des conclusions.
Emmanuelle Vajou : Il est permis de s’interroger sur la méthode retenue par la deuxième chambre civile. L’avis cite longuement la circulaire du 2 juillet 2024 pour en extraire les objectifs généraux du décret – simplification, réduction des incidents, atténuation du formalisme –, mais passe sous silence les développements de cette même circulaire qui contredisent la solution retenue.
Cette lecture sélective, voire purement politique, n’est pas illégitime : les circulaires ministérielles n’ont pas valeur normative et ne lient pas les juridictions. Mais elle révèle une tension entre l’intention affichée du pouvoir réglementaire et l’interprétation qu’en donne le juge de cassation. Le décret du 29 décembre 2023 a-t-il vraiment « simplifié » la procédure d’appel s’il faut un avis de la Cour de cassation pour déterminer la portée de ses dispositions ?
Finalement, quelles critiques formulez-vous à l’égard de cet avis ?
Matthieu Boccon-Gibod : La solution retenue, pour satisfaisante qu’elle soit du point de vue de l’accès au juge, n’en soulève pas moins des difficultés de cohérence textuelle que la doctrine ne manquera pas de relever.
L’article 954, alinéa 2, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, dispose que le dispositif des conclusions doit contenir l’indication de ce que l’appelant demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et, « s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ». La circulaire de présentation du décret, du 2 juillet 2024, était d’ailleurs explicite : « les chefs du dispositif du jugement, qui devaient, avant le décret, être contenus dans les conclusions, distinctement des autres éléments des conclusions, mais n’avaient pas à être repris dans le dispositif des conclusions (Civ. 2e, 3 mars 2022, n° 20-20.017, Dalloz actualité, 12 mars 2022, obs. C. Lhermitte ; D. 2022. 515 ; AJ fam. 2022. 176, obs. D. D’Ambra ; Rev. prat. rec. 2022. 8, chron. E. Jullien et R. Laher ), devront désormais obligatoirement être mentionnés dans ce dispositif ».
Comment concilier cette « obligation » affirmée par la circulaire avec la « simple faculté » retenue par l’avis ? La Cour de cassation semble avoir délibérément ignoré cette indication ministérielle, préférant une lecture systémique des textes à leur application littérale. On pourra y voir un cas de « résistance jurisprudentielle » à un texte jugé trop formaliste, ou plus prosaïquement une interprétation contra legem commandée par des impératifs d’équité procédurale.
La critique la plus substantielle que l’on puisse adresser à cet avis tient à son silence sur l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, aux termes duquel « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Ce texte, qui n’est pas nouveau, consacre le principe selon lequel le dispositif des conclusions délimite l’office du juge d’appel. Si l’appelant ne reprend pas, dans ce dispositif, la demande d’infirmation de certains chefs du jugement, comment la cour pourrait-elle statuer sur ces chefs ? N’y a-t-il pas là une contradiction irréductible entre l’avis du 20 novembre 2025 et le mécanisme même de la saisine de la cour par les conclusions ?
La circulaire du 2 juillet 2024 avait d’ailleurs anticipé cette difficulté : « Si, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’appelant omet des chefs, la cour ne devrait pas pouvoir, en application du troisième alinéa de l’article 954, réformer le jugement sur ces chefs, faute pour l’appelant d’avoir, dans le dispositif de ses conclusions, demandé l’infirmation du jugement relativement à ces chefs ».
La Cour de cassation n’a pas répondu à cette objection. Sans doute a-t-elle estimé que la question posée ne portait que sur l’effet dévolutif, distinct de la saisine de la cour par les prétentions des conclusions. Mais la distinction, pour intellectuellement satisfaisante qu’elle soit, risque de créer une situation procédurale paradoxale : la cour serait saisie, au titre de l’effet dévolutif, de chefs sur lesquels elle ne pourrait statuer faute de prétention en ce sens dans le dispositif des conclusions.
Romain Laffly : L’idée originelle de ce décret dit de « simplification » était, sur ce point, de desserrer l’étau d’un effet dévolutif qui ne s’exprimait qu’au travers de la déclaration d’appel pour donner plus de latitude aux avocats afin, aussi, de pouvoir le faire évoluer avec le dépôt des premières conclusions de l’appelant principal. Mais on voyait vite que cette faveur faite aux avocats pouvait se retourner contre eux en raison de l’exigence nouvelle propre à la rédaction du dispositif. Non seulement ils restaient sanctionnés pour l’omission d’une prétention au dispositif de leurs écritures, mais ils l’étaient désormais pour ne pas avoir détaillé les chefs du dispositif du jugement critiqués.
On voit alors toute la difficulté pour la Cour de cassation de concilier l’exigence d’un effet dévolutif qui s’étend de l’acte d’appel aux conclusions, avec un dispositif des conclusions qui prévoit que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif tandis que le chef d’un jugement n’est pas une prétention.
Le raisonnement, non retenu par la Haute Cour, pouvait être celui-là : puisque l’absence de réformation au dispositif des conclusions en tant que prétention au fond conduit la cour d’appel à confirmer le jugement ou à prononcer la caducité de la déclaration d’appel, alors l’absence du visa d’une réformation de l’un des chefs au dispositif est une prétention manquante entraînant les mêmes sanctions.
Emmanuelle Vajou : L’appel total ayant été supprimé, cette interprétation eût été conforme à l’esprit du décret du 6 mai 2017.
La faculté offerte par l’article 915-2 du code de procédure civile de compléter, retrancher, rectifier n’exonère pas les parties de l’obligation de récapituler dans le dispositif de leurs conclusions l’ensemble des chefs critiqués, même s’ils sont déjà visés dans la déclaration d’appel. Cette appréciation aurait eu le mérite de mettre l’appelant qui utilise la faculté de l’article 915-2, et qui doit ainsi nécessairement récapituler les chefs critiqués, sur un pied d’égalité avec l’appelant qui, lui, n’userait pas de cette faculté.
L’article 954 du code de procédure civile exigeant des parties qu’elles mentionnent les chefs dont elles demandent réformation et qu’elles reprennent dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédents, aurait-il été réellement d’un « formalisme excessif » d’exiger la récapitulation de ces chefs critiqués dans le dispositif des premières conclusions alors que la partie doit déjà récapituler ses prétentions de réformation et même ses moyens de fait et de droit ? Nous en doutons.
Romain Laffly : Cela dit, pouvait aussi être envisagée une voie médiane : la précision exacte des chefs du dispositif du jugement critiqués au dispositif des écritures ne s’imposerait que si l’appelant fait le choix d’étendre l’effet dévolutif par voie de conclusions. Et si l’appelant n’use pas de cette faculté, il devient inutile de les rappeler. On l’avait dit à l’époque, une prime à réussir sa déclaration d’appel dès le départ en quelque sorte ! C’est cette voie-là qui est retenue par la Cour de cassation.
Le sort des parties à l’instance d’appel doit-il être distingué ?
Matthieu Boccon-Gibod : Oui, l’avis prend soin de préciser que la solution concerne « l’appelant principal ». Cette restriction n’est pas anodine. L’intimé qui forme appel incident demeure, lui, soumis aux exigences de l’article 954 sans pouvoir bénéficier de la faculté de l’article 915-2, réservée à l’appelant principal.
Cette asymétrie procédurale, si elle peut se justifier par la différence de situation entre celui qui prend l’initiative du recours et celui qui y répond, n’en constitue pas moins une rupture d’égalité des armes potentiellement critiquable au regard de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. L’intimé qui souhaite former appel incident devra veiller à reprendre scrupuleusement, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs du jugement qu’il entend critiquer, là où l’appelant principal pourra se dispenser de cette formalité.
Romain Laffly : Effectivement, l’intimé, appelant incident, sera bien inspiré de se conformer à l’exigence rédactionnelle dès lors qu’en formant appel incident par voie de conclusions dans son délai pour conclure, il ne pourra, lui, se retrancher derrière un acte d’appel qui a fixé l’effet dévolutif.
Rappelons d’ailleurs que la possibilité de compléter, retrancher ou rectifier un dispositif prévu par l’article 915-2, alinéa 1er, ne concerne que l’appelant principal, tandis que l’obligation de lister les chefs de jugement critiqués au dispositif de ses conclusions imposée par l’article 954, alinéa 2, vise seul l’appelant, qu’il soit principal ou intimé, l’un comme l’autre ayant aussi l’obligation de concentrer les demandes de réformation dans leur délai pour conclure.
Par-dessus tout, une chose doit interpeller avec cet avis, c’est celle d’une répétition qui ne privilégie que l’appelant principal. La Cour de cassation le dit : l’appelant principal n’est pas tenu de mentionner « de nouveau » les chefs de jugement critiqués qui figuraient déjà sur son acte d’appel, sous-entendu qu’il a déjà fait le travail, tandis que l’absence de « répétition » de ces mentions au dispositif des conclusions ne saurait donner lieu à sanction, « dans cette configuration », sous-entendu uniquement pour l’appelant principal qui a listé parfaitement les chefs critiqués dès le départ.
Certes, dans une procédure d’avis, la Cour de cassation ne répond qu’à la question posée, mais si elle n’avait pas voulu distinguer l’hypothèse de l’appelant principal qui a listé sur son acte d’appel l’ensemble des chefs critiqués, elle n’aurait pas pris la peine de préciser « dans cette configuration ».
Une sanction est donc ouverte pour ceux qui ne se trouveraient pas dans cette configuration précise. On pense à l’appelant incident, à l’appelant principal qui décide de compléter ses premières conclusions de certains chefs bien sûr, mais aussi à celui qui les retranche.
Emmanuelle Vajou : L’avis réserve en effet expressément l’hypothèse où l’appelant « fait usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1er ». Dans ce cas, le périmètre de la dévolution est modifié par les premières conclusions, et la cour est saisie des chefs « ainsi déterminés ».
Mais qu’en est-il lorsque l’appelant, dans le dispositif de ses premières conclusions, ne reprend que certains des chefs mentionnés dans la déclaration d’appel ? Doit-on considérer qu’il a implicitement usé de la faculté de « retrancher » les chefs non repris, perdant ainsi le bénéfice de l’effet dévolutif sur ces points ?
Matthieu Boccon-Gibod : L’avis ne répond pas directement à cette question, mais la logique du raisonnement conduit à une réponse affirmative. Si l’appelant ne reprend dans ses conclusions que deux des quatre chefs mentionnés dans la déclaration d’appel, il manifeste par là même sa volonté de retrancher les deux autres du périmètre de la dévolution. La solution inverse – considérer que les chefs non repris demeurent dévolus – serait inconciliable avec la ratio decidendi de l’avis, fondée sur l’absence de modification volontaire du périmètre initial.
Cette interprétation impose aux praticiens une vigilance accrue. L’absence totale de reprise des chefs critiqués dans les conclusions est désormais sans conséquence sur l’effet dévolutif. En revanche, une reprise partielle vaudrait abandon des chefs non mentionnés. Le silence total protège ; le silence partiel condamne. Franchement, il y a de quoi en perdre son latin.
L’avis du 20 novembre 2025 apporte une réponse pragmatique à une difficulté née de l’empilement des textes. Il préserve l’accès au juge d’appel en refusant de sanctionner une omission formelle dépourvue de conséquence substantielle. À ce titre, il pourrait mériter approbation.
Mais la cohérence de la solution demeure fragile. L’articulation entre l’effet dévolutif de la déclaration d’appel et la saisine de la cour par les prétentions contenues dans les conclusions reste à préciser. La distinction entre l’appelant principal et l’appelant incident mériterait d’être justifiée au regard du principe d’égalité des armes. Enfin, le régime du retranchement implicite appelle des éclaircissements que la jurisprudence future devra apporter.
Propos recueillis par Laurent Dargent – © Dalloz Actualité