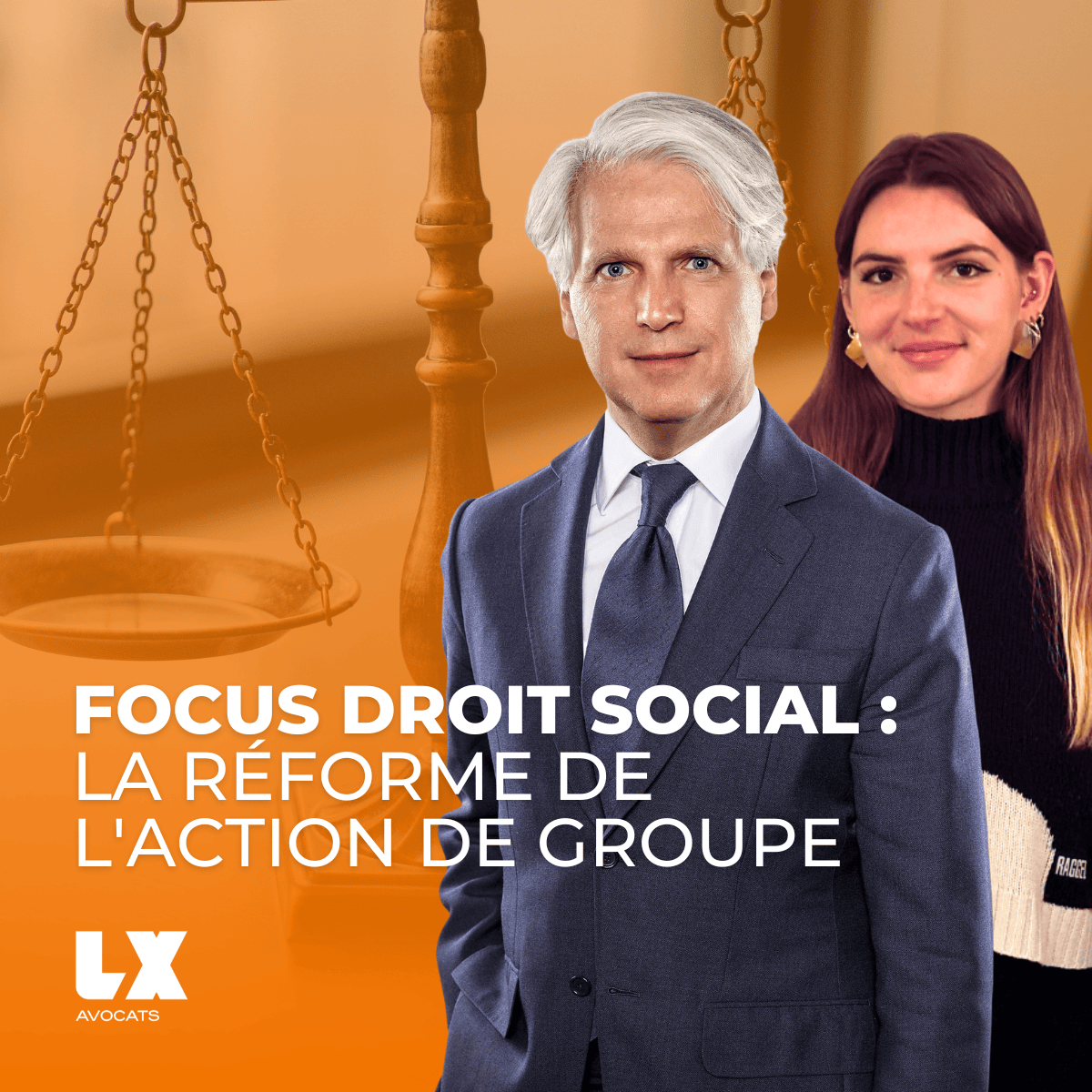Quelle conciliation l’avocat peut-il conseiller à son client ?
- Par le juge via l’Audience de règlement amiable ?
- Par le conciliateur via la conciliation judiciaire ou la conciliation conventionnelle ?
Voici un récapitulatif des conséquences du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 sur la conciliation.
La réécriture du livre V du code de procédure civile
Le livre V du code de procédure civile est entièrement réécrit et réunit en son sein l’ensemble des dispositions relatives aux modes amiables de résolution des différends conventionnels et judiciaires.
Ainsi le titre I est intitulé « Dispositions Générales » et le titre II « La Médiation et la Conciliation ».
Ce titre est divisé en 2 chapitres : la conciliation et la médiation judiciaires (chapitre 1) et la conciliation et la médiation conventionnelles (chapitre 2).
Le chapitre 2 est lui-même divisé en 2 sections, la conciliation par le juge (Section I) et les modalités du recours à un conciliateur ou à un médiateur (Section 2).
Cette division résulte de la nouvelle définition du rôle du juge édictée à l’article 21 du Code de procédure civile :
« Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elle le mode de résolution du litige le plus adapté.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige. »
Ainsi, la conciliation judiciaire peut être effectuée :
- par le juge lui-même :
- au lieu et au moment qu’il estime favorable et selon les modalités qu’il fixe, notamment en Chambre du conseil (article 1531 du CPC),
- ou il convoque les parties, d’office ou à leur demande, à une audience de règlement amiable (articles 1532 à 1532-3 du CPC),
- par le juge en déterminant avec les parties le mode de résolution amiable du litige le plus adapté, à savoir la conciliation de justice ou la médiation.
Les modifications apportées par le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025
Le décret adopte une définition commune des deux modes amiables :
« La conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose (article 1530 du CPC). »
Cette définition commune existait pour la conciliation et la médiation conventionnelles, à la différence de la conciliation et la médiation judiciaires.
La seule différence mentionnée dans le décret est que le conciliateur est « un tiers bénévole institué par le décret n°78-381 du 20 mars 1978 » (article 1530-1 du CPC) tandis que le médiateur est « un tiers en principe rémunéré » (article 1530-2 du CPC).
Au terme du décret dont le champ d’application est étendu à toutes les juridictions, à l’exception du Conseil des Prud’hommes, les dispositions communes à la médiation et la conciliation judiciaires sont donc de plus en plus importantes.
Les conséquences du décret sont différentes pour la conciliation judiciaire et la conciliation conventionnelle.
Les conséquences sur la conciliation judiciaire (articles 1531 et suivants du CPC)
L’injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur se généralise.
Auparavant, l’injonction de rencontrer un conciliateur était réservée aux seuls cas où le juge devait procéder à une tentative préalable de conciliation (ancien article 129 du CPC).
La sanction du refus ou simplement de l’absence d’une partie à la rencontre et le risque d’une amende civile d’un montant de 10 000 € maximum est précisée à l’article 1533-3 du CPC.
Cette injonction est suivie d’une conciliation conventionnelle ou judiciaire si et seulement si le juge l’ordonne dans une ordonnance dite « 2 en 1 » ou « à double détente » (article 1533 alinéa 3 du CPC).
Compte tenu de la généralisation actuelle de ces ordonnances, la seconde hypothèse sera certainement la plus suivie.
La disparition de la délégation par le juge des conciliations à un conciliateur de justice.
Auparavant le juge qui souhaitait concilier lui-même pouvait déléguer cette mission à un conciliateur de justice.
Il est maintenant prévu à l’article 1530-1 du Code de procédure civile que la conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice qui est « désigné » par le juge.
La mise au même niveau des conciliateurs de justice et des médiateurs dans le recours judiciaire à un tiers pour mener une démarche amiable
À tous les niveaux, qu’il s’agisse de l’injonction de rencontrer un médiateur ou du déroulement du processus, ce tiers conciliateur de justice ou médiateur a un rôle équivalent.
Quant au déroulement du processus amiable, aucune modification n’est intervenue à l’exception de la durée accordée au conciliateur pour le mener à bien : une durée de 5 mois, potentiellement prolongée de 3 mois (article 1534-4 du code de procédure civile).
Les conséquences de la conciliation judiciaire sur l’instance en cours sont précisées à l’article 1534 du code de procédure civile, à savoir l’interruption du délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation.
Conséquences sur la conciliation conventionnelle (article 1536 et suivants du CPC)
Le rôle du conciliateur est alors, comme le rappelle l’article 1528 du Code de procédure civile d’aider les parties à résoudre de façon amiable leurs différends et non de concilier les parties.
Une disparition des contraintes réglementaires encadrant la conciliation conventionnelle s’observe :
– Au niveau des réunions de conciliation : disparition notamment de l’incitation à venir à une réunion en présentiel (ancien article 1537 alinéa 1),
– Au niveau de l’accord de conciliation (ancien article 1540 alinéa 1) : une formulation identique est retenue sur la formalisation de l’accord. Il est toutefois prévu qu’en conciliation judiciaire l’accord peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice (article 1535 – 7 du CPC). Il est toutefois surprenant qu’il soit précisé que le conciliateur de justice, qui n’est pas partie à l’accord, doive le signer.
Pour contacter nos avocats, cliquez ici !