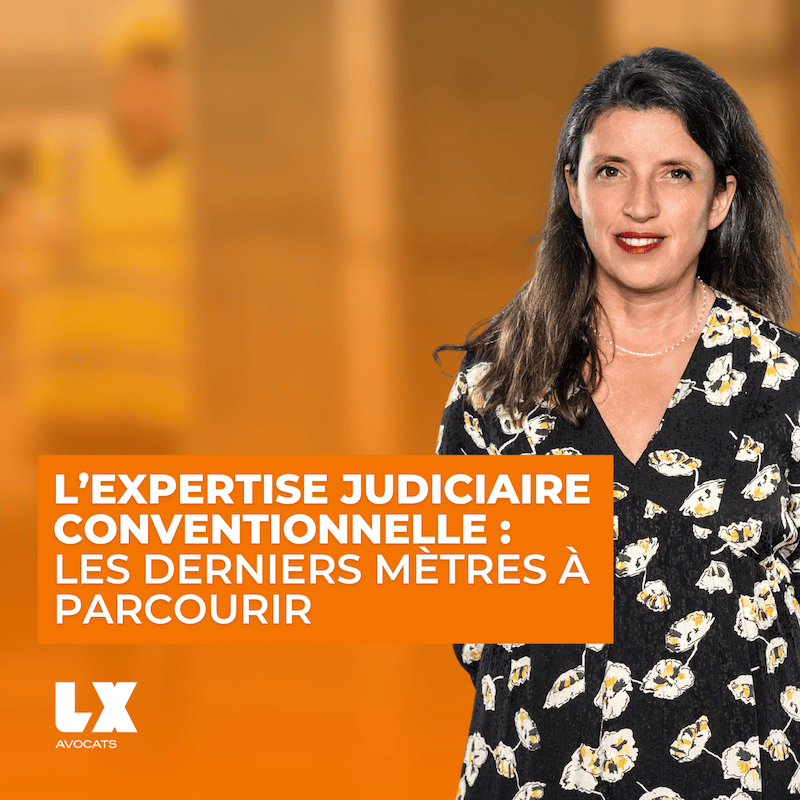Lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision de conformité rendue par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la Cour d'appel de Paris, qui dispose d’une compétence judiciaire exclusive pour connaitre de l’affaire, ne dispose que d'un pouvoir d'annulation et non de réformation de la décision de l'AMF. Cette solution, consacrée par la Cour de cassation dans l'arrêt Eurodisney du 5 juillet 2017 (Com., 5 juill. 2017, n° 15-25.121, publié au bulletin) et réaffirmé par la Cour d’appel de Paris dans une décision très récente (CA Paris, Pôle 5 - Chambre 7, 20 nov. 2025, 25/10127), marque une limite procédurale essentielle au contrôle juridictionnel des offres publiques. Mais qu'on ne s'y trompe pas : l'absence de pouvoir de réformation n'emporte nullement incompatibilité avec les exigences du procès équitable. Une juridiction d'annulation peut être de pleine juridiction.
Annuler n’est pas réformer
La distinction entre annulation et réformation irrigue le droit processuel, mais elle revêt une tonalité singulière dans le contentieux des offres publiques, notamment lorsqu’il s’agit du contrôle de leur conformité. Les recours formés à l’encontre de ces décisions sont formés en application des articles L621-30, R621-44, R621-45 et R621-46 du code monétaire et financier (CMF). Dans ce cadre précis, l’annulation consiste à retirer rétroactivement tout effet juridique à la décision attaquée, laissant l’autorité administrative libre de reprendre sa décision dans le respect du droit. La réformation, à l’inverse, permet au juge de substituer sa propre appréciation à celle de l’administration, statuant ainsi comme aurait dû statuer l’autorité initialement saisie.
Or, la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel de Paris, lorsqu’elle statue sur les décisions rendues par l’AMF en matière d’examen des projets d’offre publique, ne dispose que d’un pouvoir d’annulation et non de réformation de la décision déférée. Cette solution, énoncée dans l’affaire Eurodisney, s’inscrit dans une logique de répartition des compétences : l’AMF conserve son monopole d’appréciation technique sur la conformité des offres publiques, tandis que le juge contrôle la légalité de cette appréciation.
La formulation retenue par la Haute Cour mérite attention. Elle précise que la Cour d’appel, quoique ne disposant que d’un pouvoir d’annulation et non de réformation de la décision déférée, est saisie dans le cadre d’un recours effectif et de plein contentieux présentant toutes les garanties prescrites par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le « quoique » dit tout : l’absence de pouvoir de réformation n’affaiblit en rien le caractère effectif du recours. C’est là le cœur de l’équilibre trouvé par la jurisprudence.
Une juridiction d’annulation peut être de plein contentieux
L’affirmation peut surprendre. Comment concilier l’absence de pouvoir de réformation avec la plénitude de juridiction ? La réponse tient à la nature même du contrôle exercé. La Cour d’appel de Paris, statuant sur les décisions de conformité de l’AMF, examine tous les moyens soulevés par les parties, en fait comme en droit, et apprécie toutes les pièces produites devant elle. Elle ne se borne pas à un contrôle restreint de la légalité externe ou de l’erreur manifeste d’appréciation. Son contrôle est complet, tant sur les éléments de fait que sur les appréciations juridiques.
Mais ce contrôle plein et entier ne confère pas pour autant à la Cour le pouvoir de se substituer à l’AMF dans l’exercice de ses prérogatives de régulateur. Ainsi, puisqu’il n’entre pas dans la mission de l’AMF de se prononcer sur les violations éventuelles d’obligations (dont les sanctions de droit privé n’entrent pas dans les mesures que l’autorité est habilitée à prendre), la Cour d’appel statuant sur les recours formés contre ces-mêmes décisions n’en a pas non plus le pouvoir juridictionnel. La Cour ne peut statuer en dépassant les limites de la compétence de l’AMF elle-même.
Cette solution répond aux objections fondées sur l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation l’affirme sans détour : le fait que la juridiction de recours ne puisse réformer la décision n’emporte pas violation du droit au procès équitable dès lors que le contrôle exercé est complet et que les parties ont pu faire valoir tous leurs moyens. La plénitude de juridiction ne se mesure pas au pouvoir de réformation mais à l’intensité du contrôle exercé.
Les limites du contrôle : une cohérence, pas une substitution
Dans l’affaire Eurodisney, la société requérante reprochait à l’AMF d’avoir déclaré conforme une offre publique d’achat simplifiée alors que la société cible aurait conclu des contrats intragroupe conduisant à minorer artificiellement son résultat, et partant, à sous-évaluer le prix d’offre. La Cour d’appel de Paris avait retenu qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur ces contrats dans le cadre de l’examen de conformité du projet d’offre.
La Cour de cassation approuve cette analyse. Elle précise que c’est par une appréciation souveraine de la cohérence et de la pertinence des différentes méthodes d’évaluation mises en œuvre et des critères utilisés, qu’elle a contrôlé, que la Cour d’appel a décidé que les critiques du bien-fondé de la décision de l’AMF n’étaient pas fondées. Le contrôle du juge porte donc sur la cohérence et la pertinence des méthodes d’évaluation, non sur l’opportunité des contrats commerciaux ou sur la régularité intrinsèque de ceux-ci au regard du droit des sociétés ou du droit des contrats.
La Cour d’appel de Paris vient de rappeler ce principe dans une affaire Perrot c. Tarkett. Elle rappelle d’abord que « le Collège de l’AMF, lorsqu’il est saisi d’un projet d’offre publique d’acquisition ou de retrait, doit se prononcer sur la conformité de celui-ci aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Cette conformité s’apprécie, notamment, au regard des articles L. 433-1 et suivants du code monétaire et financier (ci-après « le CMF ») et des articles 231-1 et suivants du RGAMF, sans néanmoins que l’AMF puisse se prononcer aux lieux et place des juridictions compétentes. ». Elle souligne ensuite que « Ainsi, dans le cadre de l’examen de conformité, la cour d’appel dispose du seul pouvoir d’annulation, à l’exclusion de tout pouvoir de réformation (en ce sens Com. 5 juillet 2017, pourvoi n° 15-25.121 publié) ». Enfin, elle en tire les conséquences en déclarant irrecevable la demande de réformation de la décision rendue par l’AMF qui lui avait été soumise (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 20 nov. 2025, 25/10127).
Cette délimitation n’est pas arbitraire. Elle découle directement de la mission confiée à l’AMF par le législateur. Selon le règlement général de l’AMF, l’Autorité contrôle la conformité du projet d’offre publique « aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables », notamment en examinant les objectifs et intentions de l’initiateur, les éléments figurant dans le projet de note d’information, et, dans les cas prévus, les conditions financières de l’offre au regard du rapport de l’expert indépendant et de l’avis motivé du conseil d’administration de la société cible.
L’AMF ne contrôle donc pas stricto sensu le prix offert, mais s’assure que les informations mises à la disposition des actionnaires par l’expert indépendant et par le conseil d’administration de la société cible sont complètes, compréhensibles et cohérentes, et que le prix résulte de critères d’évaluation objectifs usuellement retenus. Comme le souligne la doctrine, le rôle de l’AMF serait celui d’un « arbitre », chargé uniquement de vérifier la cohérence des informations, l’expert indépendant et le conseil d’administration de la société cible étant en première ligne s’agissant du contrôle des conditions financières et des éléments d’évaluation.
Ce que la Cour ne peut pas faire
Comme expliqué supra, de cette définition de l’office de l’AMF découle naturellement la délimitation des pouvoirs de la Cour d’appel. Celle-ci ne saurait s’étendre à l’examen de prétendus « contournements par la société cible des dispositions du droit des sociétés » lato sensu ou de violations aux règles de gouvernance. La jurisprudence l’a rappelé avec netteté : ni l’expert indépendant, ni l’AMF dans le cadre de son contrôle de conformité d’une offre publique, n’ont le pouvoir d’apprécier la régularité d’une délibération d’un conseil d’administration au regard d’une situation de conflits d’intérêts ou le respect des règles de droit des sociétés en matière de conflits d’intérêts ou celles édictées par le code AFEP-MEDEF, ou encore par le règlement intérieur de la société cible.
De même, la Cour ne peut se prononcer sur de prétendues infractions à la réglementation relative aux abus de marché, cette compétence relevant traditionnellement du juge pénal depuis l’introduction en 1970 du délit d’initié dans l’arsenal répressif français. Le contrôle de conformité des offres publiques n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni appréciation de ses modalités, et ne vaut pas davantage authentification des éléments comptables et financiers contenus dans la note d’opération.
Cette autolimitation du juge judiciaire n’est pas une abdication. Elle traduit au contraire une lucidité sur les frontières de sa compétence. Le juge de l’offre publique n’est ni juge des sociétés, ni juge pénal, ni juge de l’opportunité économique. Il est juge de la régularité formelle et matérielle du contrôle exercé par l’AMF dans les limites de sa propre compétence.
Et quand la Commission des sanctions est en cause ?
La distinction entre pouvoir d’annulation et pouvoir de réformation prend une coloration différente lorsque la Cour d’appel de Paris est saisie d’un recours contre une décision de la Commission des sanctions de l’AMF. Ici, le silence des textes a longtemps nourri le débat. Mais la Cour de cassation a précisé que la Cour d’appel de Paris avait les mêmes pouvoirs que le Conseil d’État, à savoir un pouvoir de confirmation, d’annulation ou de réformation de la décision.
Cette différence de régime s’explique par la nature des décisions en cause. Les sanctions prononcées par la Commission des sanctions de l’AMF relèvent d’une logique répressive, soumise aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en sa dimension « pénale ». Dans ce contexte, le juge de recours doit pouvoir, en vertu de l’effet dévolutif, se prononcer sur le fond de l’affaire et substituer sa propre appréciation à celle de la Commission. La Cour de cassation a posé le principe selon lequel lorsque l’irrégularité ayant motivé l’annulation de la décision de la Commission des sanctions n’est pas de nature à affecter la validité de la procédure antérieure ni des actes de saisine, il appartient à la Cour d’appel, en vertu de l’effet dévolutif du recours, de se prononcer sur le fond de l’affaire qui lui est soumise (en ce sens Com. 24 oct. 2018, pourvoi n° 16-15.008 publié).
Le contraste est donc net. Face à une décision de sanction, la Cour d’appel de Paris dispose d’un pouvoir d’annulation, mais aussi de réformation et doit statuer sur le fond en vertu de l’effet dévolutif du recours, sauf à renvoyer l’affaire devant l’AMF pour instruction complémentaire. Face à une décision de conformité, elle ne dispose que d’un pouvoir d’annulation et ne peut se substituer à l’AMF dans l’exercice de sa mission de régulation. Deux contentieux, deux régimes.
Une réforme à venir ?
Des voix s’élèvent pour critiquer cette dualité de régime. Certains praticiens souhaiteraient que la Cour d’appel de Paris dispose d’un véritable pouvoir de réformation en matière de conformité des offres publiques, afin de gagner en efficacité et d’éviter les allers-retours entre la Cour et l’AMF. D’autres, à l’inverse, considèrent que le pouvoir d’annulation préserve utilement le rôle de régulateur technique de l’AMF et la cohérence de sa doctrine administrative.
Le législateur a récemment abaissé de cinq à trois mois le délai dans lequel la juridiction doit, dans certains cas, se prononcer sur les recours contre les décisions de conformité de l’AMF (art. L621-30 CMF), afin de limiter la durée de l’offre en cas de recours contentieux. Cette réforme témoigne d’une volonté de fluidifier la procédure, mais elle ne touche pas à la répartition des compétences entre l’AMF et son juge.
En attendant, la solution récemment rappelée par la Cour d’appel de Paris tient bon. Elle repose sur un équilibre subtil : garantir l’effectivité du recours sans déposséder l’AMF de ses prérogatives. Annuler sans réformer, contrôler sans se substituer. Tel est le paradoxe assumé d’un contentieux où le juge judiciaire, par exception, statue sur des actes administratifs unilatéraux. Une anomalie apparente qui, en réalité, traduit la plasticité du droit processuel face aux exigences du droit financier contemporain.
La Cour d’appel de Paris n’a pas le dernier mot sur l’opportunité de l’offre, mais elle a bien celui sur sa légalité. Et c’est déjà beaucoup.